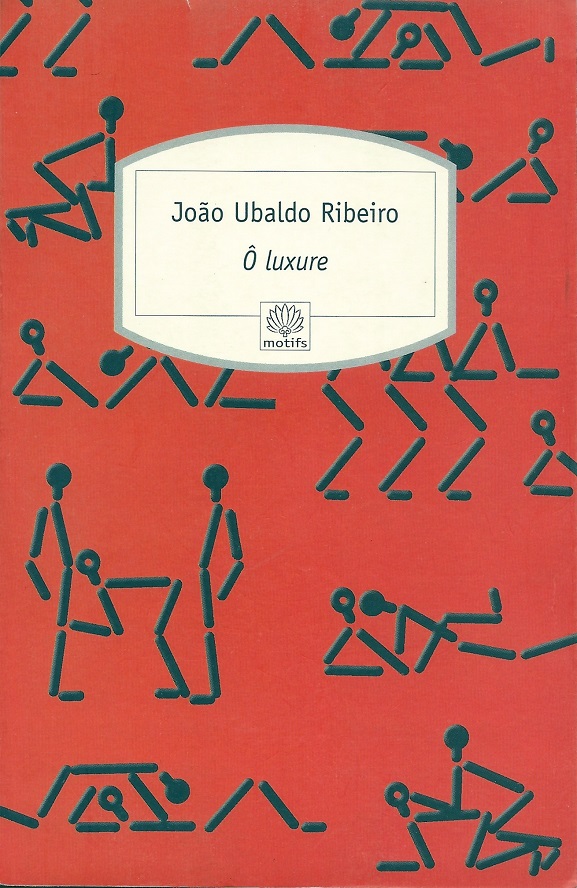Arrivée en banlieue parisienne trois semaines jour pour jour après avoir
été glissée dans une boîte postale de la banlieue de São-Paulo, cette BD a
parcouru 9500km, franchi deux océans et traversé sept méridiens à la vitesse
éclair de 19 kilomètres à l'heure, sans doute un record dans le genre, mais ce
n'est pas la raison pour laquelle on en va parler.
Introuvable en France, et pas même disponible sur le Web, Jubiabá m'a donc
été envoyée par l'auteur, João Spacca de Oliveira, lequel a répondu à ma
demande à la façon des brésiliens : avec amabilité, obligeance et simplicité.
Merci à lui, ou muito obrigado, comme on dit là-bas.
Ceci étant, il ne faudrait pas croire qu'un excès de complaisance pour
l'auteur, voire même de sympathie pour l'homme, m'incite à louer ici son
adaptation du livre éponyme de Jorge Amado. Chacun pourra en effet juger un peu
plus bas de la qualité graphique de ses dessins ou de l'harmonie de ses couleurs
: un régal pour les yeux. Concernant le scénario, nécessairement condensé, il
est aussi fidèle que possible à l'original : on y retrouve non seulement chaque
épisode de la vie mouvementée d'Antonio Balduino, mais aussi la plupart des
personnages du roman et les multiples endroits qu'ils fréquentent. Enfin, et
c'est peut-être là le plus important : la sensibilité avec laquelle Spacca a su
retranscrire l'univers d'Amado, ce mélange de violence et d'amour dans le Brésil
des années vingt et trente, aussi ce constant souci du bien et du mal, et cet
espoir de voir poindre un jour des lendemains qui chantent. Au fond, tout bien
pesé et tout bien réfléchi, peu importe le talent des uns ou le génie des
autres... mais que l'humanité d'un homme fasse écho à celle d'un autre homme à
travers le temps et l'espace, voilà, oui voilà ce qui est vraiment beau.
 Précisons encore que João Spacca de Oliveira a consacré à cet ouvrage un an
et demi de sa vie, dont six mois de recherches et de préparation, plus douze
autres mois pour dessiner et colorier chacune des 81 planches ; qu'il s'est
inspiré, entre autres choses, des magnifiques photos du français Pierre Verger
et des chansons de Dorival Caymmi, célèbre auteur-compositeur de saudades,
l'équivalent des fados portugais ; aussi que nous espérons vivre assez vieux pour voir
fleurir un jour Jubiabá dans les bacs des librairies françaises ; et enfin qu'il
a été extrêmement difficile de choisir quelles planches ou vignettes offrir en
partage, tant elles sont presque toutes réussies, hormis quelques-unes peut-être
un peu bâclées... Um abraço.
Précisons encore que João Spacca de Oliveira a consacré à cet ouvrage un an
et demi de sa vie, dont six mois de recherches et de préparation, plus douze
autres mois pour dessiner et colorier chacune des 81 planches ; qu'il s'est
inspiré, entre autres choses, des magnifiques photos du français Pierre Verger
et des chansons de Dorival Caymmi, célèbre auteur-compositeur de saudades,
l'équivalent des fados portugais ; aussi que nous espérons vivre assez vieux pour voir
fleurir un jour Jubiabá dans les bacs des librairies françaises ; et enfin qu'il
a été extrêmement difficile de choisir quelles planches ou vignettes offrir en
partage, tant elles sont presque toutes réussies, hormis quelques-unes peut-être
un peu bâclées... Um abraço.
~o~O~o~O~o~
Le petit Antonio Balduino, ici avec Zé-la-Crevette,
son professeur de guitare et de capoeira :
 |
| © Spacca - 2009 |
Celui
qu'on appelle Jubiabá, guérisseur et maître de cérémonies Candomblé :
 |
| "Son oeil de piété est parti. Seul est resté celui de la méchanceté." |
Après
l'internement de sa tante, Baldo est conduit par mame Augusta dans la maison du
conseiller Pereira :
 |
| © Spacca |
Il y
rencontre Lindinalva, la fille du conseiller, l'amour de sa vie, la fièvre de
ses nuits... un rêve inaccessible :
Mal-aimé dans son nouveau foyer, Baldo fugue avant qu'on ne le chasse. Il découvre alors la liberté de la rue et les moyens d'y survivre avec la fine fleur des pavés : Zé-la-Cosse, Le-Gros, Viriato-le-Nain, Philippe-le-Beau et Rozendo :
 |
| © Spacca |
Une fuite éperdue à travers la forêt :
 |
| © Spacca |
Et finalement la prise de conscience, juste avant l'engagement politique :
-Les ouvriers sont une immense majorité dans le monde et les riches une petite minorité. Alors pourquoi les riches sucent la sueur des pauvres? Pourquoi cette majorité travaille stupidement pour le confort d'une minorité? Tous les ouvriers, les intellectuels pauvres, les paysans et les soldats doivent s'unir contre le Capital...
-Que signifie être contre le Capital ?
-"Capital" et "Riches" ça veut dire la même chose...
-Ah, alors je suis contre aussi...
Jubiabá (Bahia de tous les saints), 96 pages parues aux Ed. Quadrinhos na Cia, en 2009.
Illustrations et adaptation de Spacca ©, d'après l'oeuvre de Jorge Amado.
Les maisons Casterman, Dargaud, Dupuis, Delcourt ou Glénat sont priées de contacter urgemment les Editions Schwarcz LTDA, à São Paulo, afin de récupérer les droits de cette bande dessinée pour la mettre à disposition du public français, lequel leur vouera alors une reconnaissance éternelle :
 |
| © Spacca |