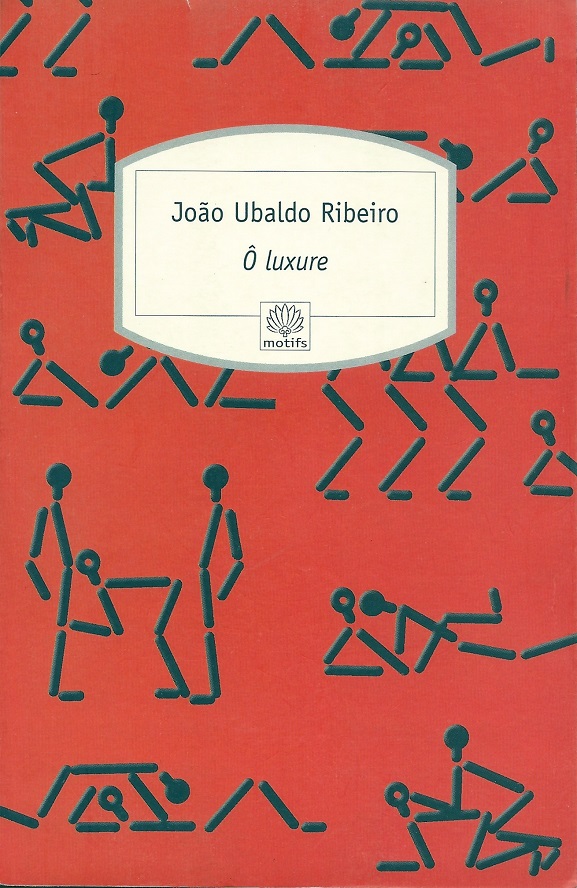Petit come-back en terre brésilienne, qu'on ne finira jamais d'explorer tellement ce pays est immense, y compris d'un point de vue littéraire, avec des auteurs à ranger au rayon des plus grands, tels qu'Erico Veríssimo, Antônio Torres ou encore João Ubaldo Ribeiro. De ce dernier, nous avions beaucoup apprécié Vive le peuple brésilien, un livre au titre un peu rebutant mais superbement rédigé, d'une incomparable drôlerie et de grande érudition, toutes deux mises au service d'une noble cause : le métissage des cultures. Pour Sergent Getúlio, son deuxième opus, nous serons nettement moins élogieux, sans doute parce que Ribeiro use du même procédé romanesque que pour Ô luxure, à savoir le monologue narratif, mais un monologue ici tant et si bien déjanté que l'on peine à en suivre le fil, malgré un thème intéressant : la violence ; celle du narrateur, bien sûr, mais surtout celle de tout un corps social pour ainsi dire cristallisée dans le narrateur.
Nous sommes aux alentours des années 50, sur fond de campagne électorale et, ainsi qu'il en était encore de coutume au Brésil, de luttes sanguinaires pour la conquête du pouvoir, de règlements de compte et autres vengeances personnelles. Le narrateur, Getúlio Santos Bezerra, est un ancien cireur de godasses devenu sergent de la police militaire et homme-à-tout-faire d'un chef de Parti qui l'a pris sous son aile après qu'il ait tué son épouse adultère quelques années plus tôt. Nous savons aussi qu'il a froidement assassiné depuis lors deux ou trois dizaines d'individus désignés par son "patron", et qu'il a reçu cette fois-ci pour mission de s'emparer d'un rival politique afin de le conduire de Paulo Afonso jusqu'à Barra dos Coqueiros ; soit un voyage d'environ 200km à travers le Sergipe et à bord d'une vieille Hudson conduite par Amaro, son fidèle acolyte. En cours de route, tandis que les deux hommes infligent à leur prisonnier d'impensables sévices, un subalterne vient les trouver pour les informer d'un contre-ordre émanant du Chef et leur intimant de libérer le prisonnier sur le champ pour cause de pressions médiatiques, ce à quoi ne peut se résoudre le sergent Getúlio, un homme d'honneur pour qui une parole donnée est une parole sacrée, aussi un homme qui obéit d'abord et avant tout à des principes, quoi qu'il en coûte, y compris le bain de sang par lequel s'achève cette histoire.
Voilà, voilà... En fait, je ne sais pas trop quoi penser de ce livre, si ce n'est qu'il ressemble à un puzzle assez difficile à assembler, et qu'il est ponctué d'un bout à l'autre par des scènes de violence comme on en lit rarement... hormis dans les journaux.
 |
| João Ubaldo Ribeiro (1941-2014) |
La goutte sereine est ainsi, vagabonde. On la laisse, elle se transforme en chancre et dégénère en autres misères, de sorte qu'il faut se précautionner contre les femmes de rencontre. Premier précepte. De Paulo Afonso jusque-là, une tirée, encore pire de nuit dans ces conditions. [...] C'est du sertão sauvage : cactus et chardons géants, tout traîtrise, queues-de-rat en dessous, un enfer. Plantes et femmes nuisibles, possibilitant des plaies ; bestioles sournoises, fourmis, scorpions, tiques, faut voir. J'ai tué trois malheureux par-dessus des queues-de-rat, dont un qui arriva doucement à terre, redoutant les épines sans doute. Comme si un qui va mourir se préoccupe de son confort. J'aurais eu le goût de saigner j'achevais le vivant sur le coup, pourtant il fait un bruit bizarre et il n'est pas propre à cause de tout ce jus qui sort. De façon que je lui tirai dans le crâne, en visant bien pour ne pas gaspiller de munitions. Là-dessus je jurai contre lui, qui m'obligeait à chasser à travers ces maquis, perdu dans cette fournaise, gâchant mes bottines neuves dans ces ronces difficultueuses. On ne voit que têtes-de-moine, yuccas, méchants buissons et urubus. Il n'entendit même pas le juron, il retomba et refroidit. Du travail régulier. [...] Ensuite les urubus, car le travail n'est plus de punition, il est de nettoyage. L'urubu c'est la propreté des campagnes, il repère la minute où quelqu'un cesse de marcher dans ces agrestes et reste à tournoyer comme un espirite. Il tournoie comme ça, claquant du bec et ufeufant des ailes, ces planements plumés, âmesempennés. Il va et reva et va et vient. Il doit avoir un souffle notable. On sait que le petit urubu naît blanc et qu'ensuite il devient noir et s'il voit un homme il vomit de dégoût, il a le cœur soulevé. Eux ils nous dégoûtent, nous on les dégoûte. [...]
~oOo~
[...] Ce n'est qu'après un moment qu'il exposa ses idées.
— Impossible de tuer l'homme, quelqu'un peut venir ici. Ça ferait parler de moi, ça je ne supporte pas.
— D'accord, d'accord. On peut le rosser.
— En plus, je le laisse estropié. Vous, vous brûlez ?
— Je n'ai jamais brûlé même un œuf de bouc, encore moins lui.
— Il n'y a pas de difficulté. On pose le fer chaud. Ça fait comme une odeur de viande roussie, mais c'est nécessaire, parce que sinon il peut saigner de trop et l'animal meurt de se vider. Comme ça, on brûle et ça sèche, ça reste parfait.
Amaro dit qu'on pouvait attacher un crin de queue de cheval à la racine des couilles, et on étrangle, étrangle jusqu'à ce que ce soit comme de la bouillie de manioc. Juste, dit Nestor, mais alors il peut tirer, dans un moment de distraction de celui qui surveille. Mais c'est le mieux, dit Amaro, c'est le meilleur moyen pour ôter les verrues, on ne souffre même pas, ça déconforte seulement. Si vous coupez, votre main peut glisser et tout couper d'un coup, ça fait des dégâts. Il n'y a pas d'homme qui reste calme dans un de ces moments.
— On l'avise : regarde, si tu brailles, je t'enfile dans la bouche un chiffon bien enfoncé et tu peux t'étouffer. Mieux vaut te conformer, parce que le destin ne se trompe pas. Ne remue pas non plus, parce que ça complique. Laisse que je coupe d'un coup, à la racine, c'est l'affaire d'un instant.
— On peut aussi écraser au pilon, pas besoin d'envelopper, il y a déjà un emballage naturel. On peut piler, piler, jusqu'à ce que ça se mette en farine, et alors on laisse, ça enfle et ça pend. Ça donne un couillon impressionnant, il peut aller jusqu'au genou. [...]
~oOo~
[...] Alors donc assis dans ce pacage, avec ces cendres que j'ai mises sur ma tête et tous ces chemins que j'ai creusé de mes pieds, tournant en rond je ne sais combien de temps et me frappant la poitrine et hoquetant dans ma gorge, j'ai poussé un cri qui s'est entendu dans tout l'Etat de Sergipe, de tous les côtés, en bas, en haut, jusqu'au bout du monde, qui a retenti, j'ai poussé le cri le plus terrible qu'on ai poussé sur terre, parce que c'est maintenant que j'ai senti. D'abord, je me suis assis sur une souche et j'ai plongé ma tête entre mes deux jambes allongées et je suis resté assis vingt-deux heures, cinquante-huit heures, je suis resté assis plus d'heures que jamais personne n'est resté assis, et je n'ai pas bougé ; je regardais le sol mais sans rien voir, seulement le sol d'une couleur seule. Ensuite je me suis levé et il m'est venu une rage, la plus grande rage qu'il y ait jamais eu dans tout l'Etat de Sergipe, il m'est venu une rage drue comme du sang et lourde comme cinq cent sacs de sucre et chaude comme une braise de la taille d'un bœuf. Et une fois debout j'ai étiré un bras le poing fermé, j'ai étiré l'autre bras et je me suis frappé la poitrine, tant qu'il tonna et que les feuilles des arbres tombèrent, et ensuite j'ai marché des pas de deux brasses et quand je marchais à chaque pas montaient des nuages de poussière qui devinrent de la boue sur ma figure avec les larmes qui sortaient.
João Ubaldo Ribeiro : Sergent Getúlio (1971)
Traduit et préfacé par Alice Raillard (1978)
Aux Editions Gallimard