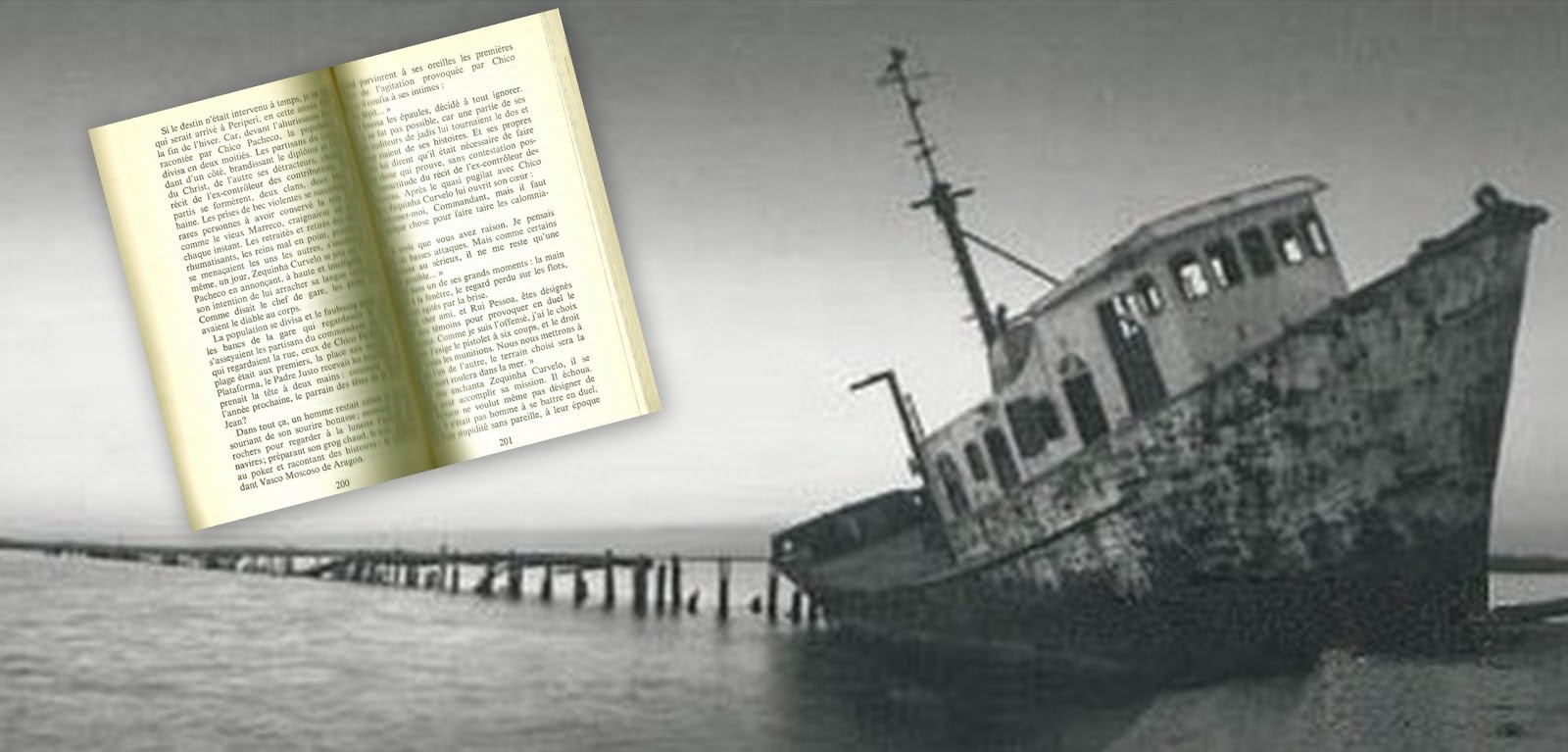« Si on me presse de dire
pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer (...) Nos âmes ont
marché si uniment ensemble (...) que non seulement je connaissais la sienne
comme la mienne, mais que je me serais certainement plus volontiers fié à lui
qu’à moi à mon sujet » (Michel de Montaigne parlant de son ami Etienne de La
Boétie)
Y a des gens avec qui le courant
passe formidablement bien, et pas seulement des écrivains. Ça ne tient ni à
l'âge, ni au sexe, ni même à la couleur de la peau : c'est une question de
conductivité, d'atomes basiques, de particules élémentaires.
Ce peut être, par exemple, un gars croisé par hasard sur son lieu de travail — et ce sont alors des
discussions à n'en plus finir, des pensées qui s'échangent en confiance,
avec sincérité et sans faux-fuyants, ceux de la comédie sociale que l'on joue si
souvent entre soi.
Ce peut être encore une fille
rencontrée lors d'une soirée entre amis et que l'on croit connaître depuis toujours,
tellement son regard posé sur le monde nous paraît d'emblée familier, tellement
aussi sa voix, ses gestes et même jusqu'aux battements de son cœur s'accordent
instantanément aux nôtres, tous deux vibrants d'un souffle si conjoint qu'on ne
peut les séparer sans les déchirer — c'est une manière de se parler ET de
s'écouter ; c'est la sensation d'être enfin compris ; l'illusion d'avoir trouvé
l'âme sœur ; les heures qui filent sans qu'on les voit passer... et le vaste
univers qui se réduit soudain à rien, comme englouti par l'amour qu'on ressent
l'un pour l'autre. En un mot : le bonheur.
Ça peut donc être un gars ou une
fille, n'importe qui de vivant, mais ça peut être aussi un ancien combattant dont on épluche la correspondance
et avec lequel, malgré la distance, on se sent immédiatement proche,
n'éprouvant bientôt pour lui que vive et belle sympathie, sans que l'on ne
sache vraiment ni pourquoi ni comment, hormis : Parce que c'estoit luy et
parce que c'estoit moy.
Charles Raguet, illustre inconnu dont on ne
trouvera quasiment aucune trace sur le web, est né le 28 février 1882 à
Colombé-le-Sec, dans le département de l'Aube, région Champagne-Ardenne. Issu
d'une famille d'agriculteurs, et paysan lui-même, il exploitait sa propre ferme
sans rien devoir à personne, en célibataire endurci, le dos déjà un peu voûté,
les mains calleuses, la peau tannée par les travaux des champs. Il aurait pu
vivre heureux et longtemps, finissant peut-être par trouver femme à son goût,
puis lui faisant des enfants qu'il aurait vu grandir année après année, n'ayant
d'autre ambition pour eux que d'en faire des hommes à leur tour et, le moment
venu, ainsi que font les pères, de leur léguer à la fois ses terres et son
grand savoir.
Courant des années 1960, Charles
Raguet aurait pu être un vieillard usé et fatigué, malade de
pied en cap et même quasi-mourant sur son grabat, mais il aurait somme toute
bien vécu... si le sort n'en avait pas décidé autrement.
En août 1914, après avoir fauché
et engrangé sa luzerne, Charles embrassa tendrement les siens, puis quitta son
village avec l'espoir de les revoir un jour. Sergent à la 23ème Cie du 156ème
R.I., il accompli durant 9 mois son devoir militaire, sans zèle ni
plaisir, mais parce qu'il le fallait, tout simplement. C'est ainsi qu'il
participa à la bataille des Frontières puis à la Course à la mer, aussi à la
bataille des Flandres puis à l'offensive de l'Artois. Et c'est là, aux environs
du Bois-le-Prêtre, tandis qu'il regagnait l'arrière, qu'un obus de 210mm devait
lui ôter la vie, en mai 1915.
Ses lettres, à l'écriture vive et
énergique, sont adressées pour la plupart à sa sœur, Marie-Antoinette — de cinq ans son aînée et veuve depuis peu —, et quelques autres sont destinées à sa mère, Hortense, veuve également. A toutes deux il ne cache rien de ce qu'il voit et ne camoufle
qu'à peine les nombreux sentiments qu'il ressent.
De l'homme, j'ai apprécié la
sensibilité non feinte, la franchise de ton, la dureté au mal, le sens des
réalités, l'attention qu'il portait aux hommes aussi bien qu'aux bêtes et à la
nature en général.
Du militaire, j'ai aimé l'absence
de haine à l'égard des Allemands, l'aspiration constante à la paix, aussi
l'instinct un peu animal de qui est aux aguets et, surtout, que son
enthousiasme des premiers jours soit si rapidement remplacé par
une prise de conscience de plus en plus fine de la tragédie humaine qui se
déroulait sous ses yeux et à laquelle, sans jamais l'avoir pourtant désiré, il
participait.
Morceaux choisis :
Août 1914 :
 Tout va bien et je pense bien aller faire une
manille en Allemagne.
Tout va bien et je pense bien aller faire une
manille en Allemagne.
La guerre, qui devait durer 5 ou 6 mois sera de
beaucoup réduite. Notre Etat-Major est bien supérieur à celui de l'Allemagne,
qui va se laisser prendre dans un traquenard, vous pouvez avoir confiance.
Tu n'es peut-être pas très rassurée en voyant les nouvelles
des journaux. Je te conseille de ne pas faire attention à eux (...) Ici nous
avons de vraies nouvelles, et des bonnes, quoique nous avons tout de même
quelques tués.
Les allemands sont de mauvais soldats : leur force
est constituée par leur nombre et c'est tout.
Septembre 1914 :
Je suis toujours en bonne santé. Malheureusement, il
y en a beaucoup qui ne peuvent en dire autant et ce n'est pas fini. Si tu
voyais les hôpitaux militaires t'en verrais des malheureux avec des bras et des
jambes coupées et des yeux crevés ou la tête traversée d'une balle... enfin,
j'ai vu une fois et cela m'a suffit.
Je voudrais bien savoir quand nous en serons quitte
avec ces boches. Ils sont plus solides que je ne pensais, mais nous en
viendrons à bout tout de même, avec le temps.
Octobre 1914 :
Je voudrais bien, si toutefois je laisse ma peau par
là, que tu profites, ainsi que notre mère, du peu que je possède. Alors, si tu
veux bien, tu feras faire un testament comme quoi je vous laisse tout, si
jamais je meurs sur les champs de bataille.
Jusqu'à ce jour, rien de nouveau. Nous sommes en
pleine gaieté, nous chantons tous sans penser à ce que l'avenir nous réserve.
Il vaut mieux qu'il en soit ainsi, car si on réfléchissait, depuis 2 mois que
nous sommes là, nous serions tous malades.
Novembre 1914 :
Vaudrait bien mieux que cette guerre soit finie et
que l'on nous libère, mais on n'en est pas encore là. C'est bien malheureux,
car ceux qui n'auront pas été tués seront probablement rhumatisés. Tu vois que
l'avenir n'est pas épatant [cf. scan].
Décembre 1914 :
C'est drôle, nous sommes comme des lapins de garenne
: on sort la tête de sa tanière dès que le canon cesse de tonner.
On se croirait au mois d'août par un fort orage :
les pièces de marine ressemblent tout à fait, lorsqu'elles se font entendre, à
des coups de tonnerre.
Hier matin, la canonnade a repris de plus belle.
Nous avons 100 pièces de canon qui ont tiré chacune 2000 obus à 50 francs le
coup : 10 millions de semer pour nous débarrasser des boches ! Nos grosses
pièces tiraient derrière eux, nos moyennes au milieu et les plus petites à la
fois devant et dans leurs tranchées. Beaucoup sont morts.
Avant hier, avant que je n'arrive, un cheval avait
passé la nuit recouvert de boue. Seule la tête émergeait de cette boue et il a
fallu deux chevaux, le lendemain, pour l'arracher de cette triste position. Il
était comme paralysé et ne pouvait se tenir sur ses pattes. Je me demande ce
qu'il est devenu.
Janvier 1915 :
C'est tout de même curieux que le mur de la grange
se soit effondré. D'après ce que les maçons m'avaient dit, il pouvait tenir
encore 10 ans. Enfin, ce n'est rien, ici il y en a d'autres qui se démolissent
tous les jours.
Je ne veux pas donner de punitions à mes hommes,
quoique mes officiers supérieurs le voudraient, car ces punitions seraient trop
sévères, surtout en temps de guerre, et une balle aurait vite fait de s'égarer
(...) J'ai affaire en grande partie à des parisiens très durs à commander. Il y
en a beaucoup qui connaissent le couteau, mais, comme je te le disais, il ne
faut pas te tourmenter pour moi : je passerai à travers tout cela et je m'en
tirerai.
PS : ne fais pas voir ma lettre.
A Colombé-le-Sec vous vous plaignez avec juste
raison, mais si vous habitiez le pays où nous sommes vous en verriez bien
d'autres. Pas une maison ici qui n'ait été brûlée ou bombardée. L'église est
criblée de balles, tout est saccagé, on ne rencontre que des vieilles horloges
cassées sous les décombres, il ne reste plus rien.
Février 1915 :
D'après un livre que nous avons lu, chaque coup
d'obus leur coûte 500 francs. Tu vois ce qu'ils dépensent pour ne pas nous
faire grand mal.
Vivement que ce Guillaume II crève et que l'on soit
enfin tranquille.
Mars 1915 :
Je me porte toujours bien, mais il faut avoir soin
de baisser la tête. Le moindre bruit que l'on fait, ou le peu que l'on se
montre, et les balles nous sifflent aux oreilles. Hier, deux têtes en l'air ont
voulu faire les marioles en jetant des pierres aux boches, puis ils se sont mis
à genoux au-dessus de nos abris pour tirer sur un petit poste allemand, mais ils sont
vite redescendus, l'un avec trois balles dans la peau, l'autre une seule,
mais juste au-dessus de l'œil.
Ici il faut être prudent. Nous sommes très près des
boches. Les fusils sont braqués sur les sentinelles et au moindre mouvement ça
y est. Malgré cela, je ne désespère pas encore. Il n'est pas possible de nous
surprendre, il n'est pas non plus possible de se sauver. Il faut tenir bon et
c'est tout.
Nous avons eu une attaque avant-hier. Ces messieurs
avaient commencé par nous lancer des bombes qui dégagent beaucoup de fumée et
font un bruit démoralisant. Quelques-uns se présentent et voilà l'attaque
déclenchée. Après avoir tiré un cent de cartouche chaque homme, le feu s'est
arrêté. Hier matin, nouvelle attaque : une de nos tranchées a sauté et il y a
eu du sang de versé. A 6h00 du soir, ça reprend de plus belle, ce n'était
qu'étincelles et vive canonnade. Et ce matin, à 4h1/2, ça recommence encore. Je
ne peux pas te dire le résultat, toujours est-il qu'il faut des brancardiers
après ces séances. Bref...
C'est bien malheureux de vivre comme ça, couché tout
équipé, souliers aux pieds six jours sur huit, mais on s'y habitue. Les petits
oiseaux aussi. Ils viennent chanter près de nous. Les balles sifflent et ils ne
s'envolent pas. C'est curieux.
Il ne se passe pas 3 minutes sans qu'un boche nous
envoie quelques balles. Si cela dure encore longtemps, ça me coûtera cher pour
ne pas beaucoup me rapporter, surtout si je ne suis plus là. Ça commence par me
dégoûter, cette vie-là.
Tu vois des hommes qui tombent de peur et d'autres
qui tirent sans viser tellement ils ont les foies. Il est vrai que ça n'a rien
d'amusant.
Je viens de recevoir une lettre de la mère
m'annonçant la mort de Léon Mangé. Heureux celui qui en sortira sain et sauf de
cette triste guerre. Vivement que tout cela finisse, car il ne restera pas
grand monde si l'on continue.
C'est très dur de vivre comme ça. Par moment on s'en
dégoûte et on voudrait savoir si on en sortira mort ou vif. Mais si c'est pour
mourir, eh bien que ça soit tout de suite. Si je savais finir mes jours à la
guerre, je demanderais à partir pour la Serbie, j'aurais toujours l'agrément
d'en faire le voyage.
Le bruit court que nous allons attaquer d'ici quatre
jours. Espérons que je m'en sorte. N'en parle pas à la mère.
Nous étions loin de penser, lorsque nous avons fait
le dernier repas à Troyes, en compagnie de René Darlet, que quelques mois plus
tard l'un de nous deux manquerait à l'appel.
Très heureux de descendre en seconde ligne pour me
reposer deux nuits d'affilée, je chantais en compagnie de mes collègues, mais
le chant a brusquement cessé en prenant connaissance de la mort de ce pauvre
Léon.
On s'abrutit un peu par ici et il y a des moments où
je ne sais plus comment certains mots s'écrivent. Après la guerre, tout se
remettra en place, faut l'espérer.
Avril 1915 :
J'ai entendu un homme déclarer sans la moindre
tristesse la mort de ses deux fils. Aussi une jeune femme qui venait de perdre
son mari et trouvait cela presque naturel. Seule la mère de cette jeune femme
versa une larme en y pensant et en nous disant que son gendre était bien
gentil.
Je t'assure que voilà bien des obus de brûlés ces
jours-ci. Par endroit, les boches sont accrochés aux arbres par l'explosion de
nos obus. Un de nos régiments, qui se trouvait en première ligne, a sauté dans
la tranchée ennemie et a tout sabré sans pitié. Les boches criaient Kamarade,
mais se faisaient embrocher comme des cochons, les bons comme les mauvais. Bienheureux
ceux d'entre eux qui ont été fait prisonniers. D'ailleurs, hier, il en est
encore passé 11 qui étaient très heureux et riaient. Les femmes, par contre,
bien souvent, si on les laissait faire, se jetteraient sur ces prisonniers pour
les tuer.
Quelle vie ! Attendre comme un braconnier attend un
lièvre.
Il serait préférable, par ces beaux jours, d'être
derrière sa charrue plutôt qu'au Bois-le-Prêtre.
Les journaux vous racontent que le moral des troupes
est bon, ils vous bluffent, ce n'est pas toujours vrai. Quand on sort du champ
de bataille avec des pertes comme celles que nous avons subies, eh bien le
moral n'est pas si bon qu'on veut bien vous le dire et chacun de nous réclame
la paix.
Je vous envoie une photo pour que vous puissiez
revoir encore une fois ma binette, si toutefois je ne la ramenais pas.
Nous sommes très bien aérés, près d'une soixantaine
de cadavres que nous n'avons pas pu enterrer depuis voilà trois semaines. Ils
sont tout noirs et gonflés et sentent forcément mauvais. Je ne désespère pas de
voir une épidémie d'ici peu.
Je ne comprends pas que le civil ne s'occupe pas
plus que ça de la guerre. Les journaux racontent ce qu'ils veulent, mais pas
toujours la vérité. Ce n'est pas de la guerre, c'est une tuerie. Demain matin,
le 353ème attaque pour prendre des mitrailleuses boches qui sont dans une
tranchée que l'ennemi a perdue pour moitié. Nous sommes à un bout et les boches
de l'autre, seulement séparés par quelques sacs de terre. Tu peux être certaine
que ces mitrailleuses nous coûterons encore une fois beaucoup d'hommes, mais
que si jamais nous les gagnons, certains officiers seront alors cités à l'ordre
des armées et gagnerons même quelques galons dans l'histoire, c'est ça la guerre.
PS : brûle cette lettre... ou cache-là.
4 mai 1915 (jour de sa
mort) :
Chère mère,
Tu veux que je ne te cache rien, alors je vais te
parler un peu de ce que je vois tout autour de moi à travers les créneaux
(petits trous pour passer le fusil). Derrière, un terrain bouleversé par les
obus : des loques, des bidons, des fusils cassés, deux cadavres déchiquetés
(impossible d'y remarquer une tête). Devant, même bouleversement, mais avec 25
cadavres presque aussi noirs que des nègres. Les mouches bourdonnent tout
autour et ce tableau se trouve à 4 ou 5 mètres de moi. (...) Ce matin, nous
avons reçu 50 obus. Pas de blessés, ce n'était que des 77, pas très dangereux
dans les tranchées, mais quand un de ces obus tombe sur un de ces cadavres, tu penses
l'effet produit... inutile d'insister. Ce qui me fait plaisir, c'est que ce matin
60 malades ont été reconnus et évacués. Nous autres sergents, il ne nous est pas
permis d'être malade. Lorsque nous avons tant souffert à la tranchée de
Fey-en-Haye, un sous-off a été à la visite et, s'étant fait porter malade,
voici la réponse du Major : "Marche ou crève". Tu peux voir ce que
c'est que la guerre. Jamais je ne me ferai porter malade, à moins d'être blessé
ou de ne plus pouvoir marcher moi-même. Je n'aime pas ceux qui tirent au flanc,
car il faut que leurs camarades tiennent leur place. J'avais dit que je ferais
un livre de ce qui se passait dans nos parages, mais on a trop d'occupations
dans la tête et après, au repos, on aime bien dormir. Voilà nos 75 qui viennent
chatouiller les tranchées Boches. C'est souvent ennuyeux car ils sont obligés
de raser nos têtes pour toucher les leurs. Quelques fois, mais très rarement,
ils se trompent de cible et c'est nous qui recevons. Enfin, ce qu'il y a de bon
c'est que nos abris sont maintenant secs et que nous n'avons plus la boue du
mois d'avril, ni le froid. En suivant nos tranchées, là encore des cadavres.
Nous essayons d'approcher le premier que les infirmiers ont mis sur une petite
échelle et qu'ils traînent au moyen d'une corde. Je m'y suis repris à trois
fois pour l'approcher. Après avoir mis mon mouchoir devant ma bouche et mon
nez, j'y parviens, mais impossible de le reconnaître tellement il est noir et
décomposé. Plus loin, à d'autres il manque la tête et certains sont à moitié
enterrés. Voilà le temps qui se rafraîchit et la pluie qui vient. Cette nuit,
les infirmiers vont encore transporter ces macchabées. C'est un rôle qui ne me
plairait pas beaucoup non plus. Ne te fais pas de bile, va, je suis en bonne
santé, parfois fatigué, mais le coffre est bon et après un peu de repos et de
tranquillité tout se remettra en place.
Au revoir et bonjour aux amis.
Je t'embrasse, ton fils.
Charles Raguet.
VIVEMENT LA FUITE
5 mai 1915 (la
lettre qu'un camarade de Charles Raguet adresse à la mère de ce dernier, alors
qu'il vient d'être mortellement blessé par deux éclats d'obus) :
Chère madame,
Vous allez vous demander pourquoi cette carte. Si je
prends la liberté de vous écrire, c'est pour vous prévenir que votre pauvre
Charles vient d'être gravement blessé et, comme étant grand ami avec lui, j'ai
cru faire mon devoir que de vous prévenir. Lui ne peut pas écrire. Je vous
donnerai de ses nouvelles, j'irai le voir. Il a été blessé à l'épaule droite et
à la tête. Nous sommes dans une mauvaise zone où l'on se bat jour et nuit tous
les jours sans fin. Nous sommes arrosés par de gros obus qui font un mal
affreux. Nous perdons des hommes tous les jours. J'aimais bien causer avec
Charles... nous parlions du pays... Rien de plus à vous dire pour le moment.
Recevez, chère madame, mes salutations distinguées.
Portat Louis
(On notera ici la délicatesse
avec laquelle le soldat Louis Portat prépare madame Raguet: l'avisant
de l'accident mais lui cachant l'essentiel jusqu'au lendemain matin, où il lui révélera enfin la sinistre réalité)
Chère madame,
Je vais vous apprendre une bien triste nouvelle,
Charles Raguet, mon pauvre ami, est mort. Il va être enterré au cimetière
militaire qui se trouve un peu au-dessus du cimetière civil de Montauville. Il
sera seul dans sa fosse et on le mettra dans un cercueil. N'ayez crainte, tout
sera fait pour le mieux et il aura un service religieux. Je vous assure qu'il
est bien regretté par tous ses hommes, ainsi que par les officiers. C'était un
très bon garçon. C'est malheureux de voir ce qui tombe en ce moment dans ce
bois. Je m'unis à vous pour partager la grande douleur qui vous frappe, ainsi
que toute votre famille, en perdant ce bon Charles.
Recevez, chère madame, mes condoléances.
Portat Louis
Fin de l'histoire.
 A
la fois vierge et martyre en son siècle, la Sainte-Barbe, aujourd'hui en
goguette, s'intéresse tout particulièrement à trois de ses frangines plutôt
malheureuses, car soumises elles aussi au supplice amoureux : Manela, une
adolescente dont la tutrice veut préserver la fleur et les élans sensuels qui
l'entraînent vers un chauffeur de taxi ; Patricia, une jeune femme entichée
d'un séduisant curé ayant fait vœu de chasteté ; et Adalgisa, une matrone d'âge
mûr qui refuse l'usage de son corps à son footballeur de mari. Ce qui les
empêche toutes trois d'aimer, ce qui leur gâche le plaisir et leur pourrit la
vie d'une manière ou d'une autre, c'est la religion, tout du moins celle des papes
et du Vatican. On ne s'étonnera donc pas de trouver ici, dans ce roman
foisonnant, quantité d'ouailles et profusion d'ecclésiastes, la plupart au
service exclusif des classes dominantes, et quelques-uns seulement à celui des
plus démunis. On y croisera aussi de nombreux hérétiques et autres apostats, ou
plus précisément des adeptes du Candomblé, cette croyance indigène issue du croisement
des saintes figures catholiques (venues d'Europe à la proue des caravelles conquistadoriennes)
et des divinités animistes (venues d'Afrique dans la cale des bateaux négriers),
d'où la double appellation : Sainte-Barbe et Yansan (cf.
syncrétisme).
A
la fois vierge et martyre en son siècle, la Sainte-Barbe, aujourd'hui en
goguette, s'intéresse tout particulièrement à trois de ses frangines plutôt
malheureuses, car soumises elles aussi au supplice amoureux : Manela, une
adolescente dont la tutrice veut préserver la fleur et les élans sensuels qui
l'entraînent vers un chauffeur de taxi ; Patricia, une jeune femme entichée
d'un séduisant curé ayant fait vœu de chasteté ; et Adalgisa, une matrone d'âge
mûr qui refuse l'usage de son corps à son footballeur de mari. Ce qui les
empêche toutes trois d'aimer, ce qui leur gâche le plaisir et leur pourrit la
vie d'une manière ou d'une autre, c'est la religion, tout du moins celle des papes
et du Vatican. On ne s'étonnera donc pas de trouver ici, dans ce roman
foisonnant, quantité d'ouailles et profusion d'ecclésiastes, la plupart au
service exclusif des classes dominantes, et quelques-uns seulement à celui des
plus démunis. On y croisera aussi de nombreux hérétiques et autres apostats, ou
plus précisément des adeptes du Candomblé, cette croyance indigène issue du croisement
des saintes figures catholiques (venues d'Europe à la proue des caravelles conquistadoriennes)
et des divinités animistes (venues d'Afrique dans la cale des bateaux négriers),
d'où la double appellation : Sainte-Barbe et Yansan (cf.
syncrétisme). [...]
Oyà prit mille déguisements pour rendre visite aux artistes, peuple aimé d'elle
plus que tout autre, car, semblable à ces fous sublimes, elle aussi vomissait
des flammes. Elle se promena d'atelier en atelier, regardant et appréciant et,
partout où elle était passée, laissa une trace, une inspiration, une étincelle.
Pour que l'on devinât la présence de celle qui était venue, pour qu'on se
souvînt d'elle et qu'on la recréât : un coup de pinceau sur la toile, un trait
de crayon sur le papier, une entaille dans le bois, une flamme sur le métal.
Elle était vaniteuse, se savait belle, aimait à contempler son allégorie dans
les miroirs.
[...]
Oyà prit mille déguisements pour rendre visite aux artistes, peuple aimé d'elle
plus que tout autre, car, semblable à ces fous sublimes, elle aussi vomissait
des flammes. Elle se promena d'atelier en atelier, regardant et appréciant et,
partout où elle était passée, laissa une trace, une inspiration, une étincelle.
Pour que l'on devinât la présence de celle qui était venue, pour qu'on se
souvînt d'elle et qu'on la recréât : un coup de pinceau sur la toile, un trait
de crayon sur le papier, une entaille dans le bois, une flamme sur le métal.
Elle était vaniteuse, se savait belle, aimait à contempler son allégorie dans
les miroirs..jpg)





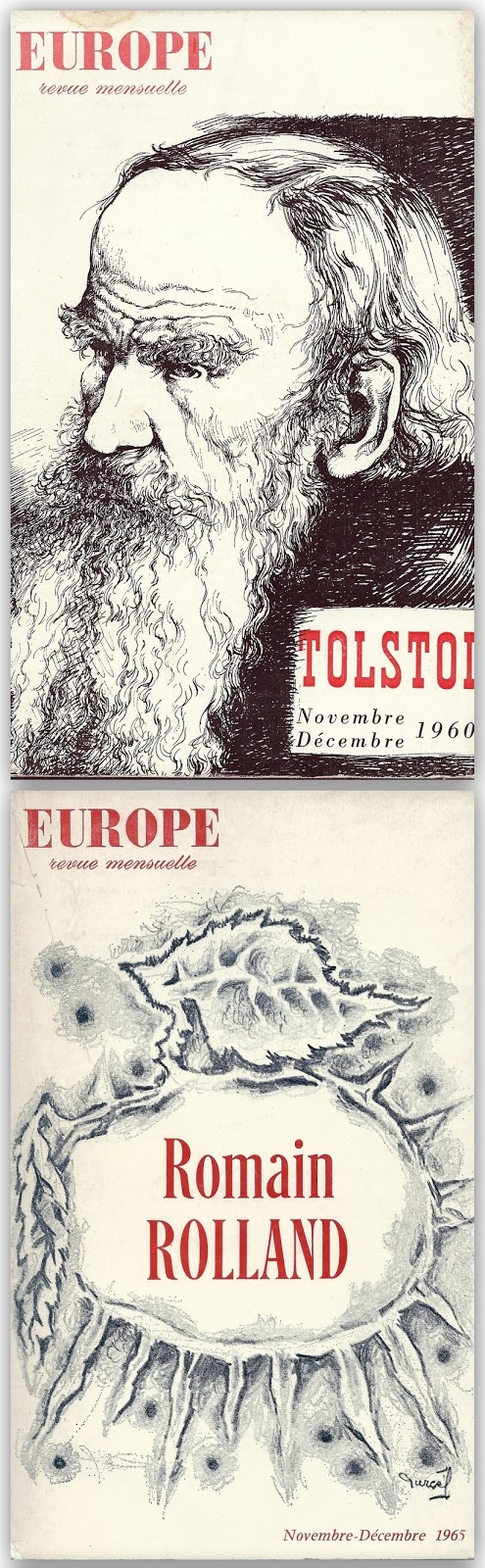

.jpg)
.jpg)







.jpg)