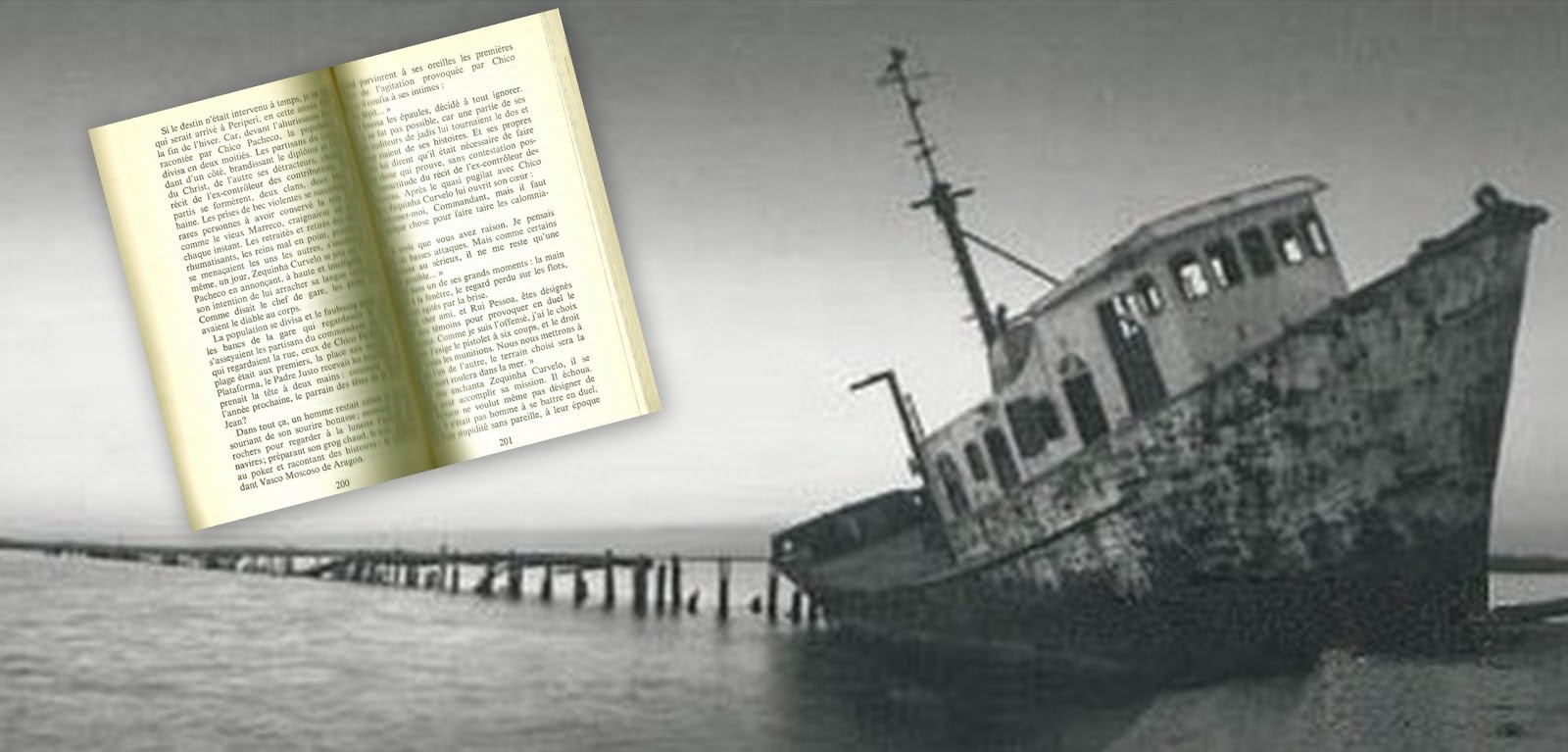« Il y a des fleurs qui sont
belles tant qu'elles sont sur les branches, dans les jardins, mais quand on les
met dans des vases, même s'ils sont en argent, elles se fanent et périssent »
(Un
personnage du roman, parlant de Gabriela à propos de son futur mariage)
Jorge Amado n'aimait pas beaucoup qu'on dise de Gabriela,
girofle et cannelle qu'elle marquait un tournant dans son oeuvre, et
pourtant il y a bien un avant puis un après-Gabriela. Et pas que dans son oeuvre, d'ailleurs :
dans sa vie aussi.
Ecrit en 1958, donc juste après la rupture d'Amado avec le Parti Communiste Brésilien, ou du moins l'arrêt de ses activités militantes, Gabriela inaugure une série de romans où non seulement l'humour devient une de leur composante essentielle, mais où la création littéraire, à présent libérée des contraintes artistiques du Parti, se fait plus débridée, le ton plus enjoué, la plume plus légère : Gabriela est le livre d'un homme qui vient de rompre avec une longue dépendance et ne maîtrise pas encore tout à fait cette nouvelle liberté. Le début du roman est en effet confus, voire brouillon, et la lecture plutôt laborieuse : impression de lire le premier ouvrage d'un auteur débutant, d'un jeune homme plein d'allant et de bagout, enthousiaste comme s'il était soûl. Et puis, peu à peu, au fil des pages, Amado trouve son rythme de croisière, en même temps qu'il adopte et peaufine le style qui sera désormais le sien : la farce sociale. Finis pour lui les pronunciamientos, les manifestes politico-romanesques, le credo coco... A présent libre de dire ce qu'il veut comme il veut, Jorge Amado prend le parti du rire : il s'anarchise, s'amuse et s'encanaille, mais sans pour autant renoncer à défendre la cause des opprimés et plus généralement les idéaux de gauche, au premier rang desquels, bien sûr, la Liberté.
L'histoire de Gabriela, girofle et cannelle
débute et s'achève au milieu des années vingt, dans la ville portuaire
d'Ilhéus, à environ 300km au sud de Bahia.
Tout commence par un triple événement :
a) un mari trompé tue à
coups de revolver sa femme adultère et son jeune amant.
b) le syrien Nacib Achcar Saad,
patron d'un bistroquet, se retrouve soudain privé de cuisinière à la veille
d'un banquet prévu de longue date.
c) le progressiste Mundinho
Falcão, fils cadet d'une richissime famille carioca, revient à Ilhéus avec la
ferme ambition de la gouverner bientôt.
De la gouverner et de l'administrer pour la
moderniser. Car la ville d'Ilhéus est une société encore semi-féodale,
archaïque et patriarcale, dominée par de vieux fazendeiros tout-puissants,
héros légendaires d'un temps révolu où la terre s'acquérait l'arme au poing et
où la plus infime des offenses, le moindre différend se lavaient dans un bain
de sang. Or, si avec Mundinho Falcão arrivent les idées de réformes et de
développement industriel, donc de progrès économiques, c'est grâce à Gabriela,
une fille simple et spontanée, issue du peuple comme il se doit (et un peu
aussi à Nacib, un étranger — tout un symbole) qu'arrivera le progrès sociétal,
l'évolution des mœurs et des mentalités.
Gabriela vient du Sertão : poussée par la sécheresse
et la famine à chercher du travail ailleurs, elle débarque à Ilhéus les pieds
nus, toute de haillons vêtue et le visage caché derrière une épaisse couche de
poussière. Recrutée par Nacib pour remplacer sa vieille cuisinière, puis
installée dans une pièce au fond du bistrot, Gabriela se révèle bientôt être
aussi bonne aux fourneaux qu'au plumard. Une perle rare et convoitée dont Nacib
Achcar Saad tombe rapidement amoureux, mais amoureux-fou au point d'en faire
d'abord son épouse, puis, comme cela arrive souvent, de vouloir en faire "sa
chose" : madame Saad doit s'habiller comme ceci, marcher comme cela,
côtoyer ces gros-bonnets-ci plutôt que ces va-nu-pieds-là, etc. Dans ces
conditions le climat du couple se dégrade assez vite car, malgré ses nombreux
efforts, Gabriela ne peut pas être autre qu'elle n'est : une jeune femme libre
comme l'air et franche comme l'eau, qui n'entend rien aux conventions sociales
de la bonne société, ni à l'hypocrisie des gens bien-pensants. Aussi, bien
qu'éprouvant toujours l'un pour l'autre des sentiments amoureux, Gabriela et
Nacib-le-Cornu se séparent sans faire trop d'esclandre... avant de se rabibocher
à nouveau, mais cette fois-ci en union libre et sans exigence de fidélité,
célébrant ainsi la victoire de l'amour et de la liberté.
Sur fond de politique politicienne, de gueuletons généreusement arrosés et de sexe à gogo, Gabriela, girofle et cannelle est donc bel et bien, quoiqu'en dise Amado, un livre de ruptures : rupture du contrat de travail entre Nacib et Josefina, sa vieille cuisinière ; rupture de Manuela d'avec son père trop autoritaire ; rupture des traditions électorales où l'on votait toujours pour les caciques locaux ; rupture des liens sacrés du mariage entre Nacib et Gabriela... (et, simple coïncidence, fruit du seul hasard : rupture entre Jorge Amado et le Parti Communiste Brésilien).
En extrait, non pas un portrait de Gabriela mais de Manuela, une autre figure féminine importante du roman. Manière d'illustrer le contraste de générations entre une mère et sa fille, le tout agrémenté de quelques us et coutumes locales :
 |
| Photographies de l'italo-brésilien Giancarlo Mecarelli (www.fromparaty.com.br) |
Dans la nuit sans lune, une silhouette, svelte et intrépide, escaladait les rochers. C'était Malvina, nu-pieds, tenant ses souliers à la main, le regard décidé, à une heure où les jeunes filles sont au lit en train de rêver, dans leur sommeil, d'études, de fêtes, de mariage. Malvina rêvait tout éveillée en gravissant les rochers.
Il y avait là une cavité creusée dans la pierre par
les tempêtes, formant un large siège face à l'Océan. Des amoureux s'y
asseyaient, les pieds au-dessus de l'abîme. En bas les vagues se brisaient et
tendaient leurs blanches mains d'écume en appelant. C'est là que Malvina alla
s'asseoir, comptant les minutes, attendant avec anxiété.
Son père était entré dans sa chambre, silencieux et
dur. Il lui avait pris ses livres, ses revues et avait cherché des lettres, des
papiers. Il ne lui avait laissé que quelques journaux de Bahia et la douleur,
la révolte de la chair meurtrie, noire de coups. Le petit mot d'amour — « Tu es
la vie que je retrouve, avec la joie que j'avais perdue, l'espérance qui était
morte. Tu es tout pour moi» — et elle l'avait gardé sur son sein. Sa mère
aussi était venue lui apporter de la nourriture et lui donner des conseils.
Elle avait parlé de mourir. Etait-ce une vie pour elle, entre un tel père et
une telle fille, entre deux orgueils ennemis, deux volontés inébranlables, deux
poignards dégainés ? Elle priait les saints de lui permettre de mourir. Oh !
pour ne pas voir s'accomplir de destin inéluctable, pour ne pas voir arriver
l'inexorable malheur !
Elle avait embrassé sa fille et Malvina lui avait
dit :
- Malheureuse comme vous, jamais je ne le serai,
mère.
- Ne dis pas d'absurdités.
Elle ne dit plus rien car l'heure du choix était
arrivé. Elle partirait avec Rômulo, elle irait vivre.
[...] De qui Malvina tenait-elle cet amour de la
vie, ce désir anxieux de vivre, cette horreur de la soumission, cette
répugnance à baisser la tête et la voix en présence de Melk [son père] ? De
lui-même peut-être. Très tôt, elle avait détesté la maison et la ville, les
lois et les mœurs, l'existence humiliée de sa mère tremblant devant Melk,
toujours consentante, jamais consultée pour les affaires. Il arrivait et lui
disait d'un ton autoritaire :
- Prépare-toi. Aujourd'hui, nous allons à l'étude de
Tonico signer un acte.
Elle ne demandait pas de quel acte il s'agissait, si
c'était un achat ou une vente. Elle ne cherchait pas à le savoir. Sa
distraction, c'était l'église. Melk avait tous les droits, il décidait de tout.
Sa mère s'occupait de la maison, c'était son seul droit. Son père fréquentait
les cabarets et les bordels, se payait des prostituées, jouait dans les hôtels,
dans les bars, tout en buvant avec des amis. Pendant ce temps, sa mère
dépérissait à la maison, écoutait et obéissait. Pâle et humiliée, résignée à
tout, elle avait perdue la volonté et n'exerçait même aucune autorité sur sa
fille. Malvina s'était juré, encore toute jeunette, qu'avec elle il en irait
autrement. Elle ne s'était pas soumise. Melk accédait à certains de ses désirs
et parfois restait à l'observer, pensif. Il se reconnaissait en elle à certains
détails, dans le désir de s'affirmer. Mais il la voulait soumise. Quand elle
lui avait fait part de son désir d'entrer au lycée, puis à la faculté, il avait
décrété :
- Je ne veux d'une fille docteur. Tu iras au collège
des bonnes sœurs pour apprendre à coudre, à compter, à lire et à pianoter. Tu
n'as pas besoin d'autre chose. Une femme qui prétend au titre de docteur est
une tête folle qui cherche sa perdition.
Elle avait pu observer la vie des autres dames,
semblable à celle de sa mère. Soumises à leur maître. Pire que si elles étaient
nonnes. Malvina s'était juré que jamais, au grand jamais, elle ne se laisserait
asservir. Dans la cour du collège, bavardaient, juvéniles et souriantes, des
filles de riches. Leurs frères étaient à Bahia, au lycée ou en faculté. Ils
avaient droit à des subsides, dépensaient de l'argent, faisaient ce que bon
leur semblait. Leur seule prérogative à elles était cette brève période de
l'adolescence. Les fêtes du Club Progrès, les amourettes sans conséquences, les
billets doux échangés, les timides baisers dérobés au cinéma, en matinée, ou
parfois, plus prolongés, dans les portails des jardinets. Un jour, le père
arrivait avec un ami. Finies les amourettes. Les fiançailles commençaient. Si
elles refusaient, le père les contraignait. Il advenait parfois que l'une
épousât son amoureux quand le jeune homme plaisait aux parents. Mais cela ne
changeait rien. Que le mari fût présenté et choisi par le père ou que ce fût
l'amoureux envoyé par le destin, le résultat était le même. Une fois mariés, il
n'y avait aucune différence. Le mari était leur maître et seigneur, il faisait
la loi et voulait être obéi. Pour lui, tous les droits, pour elles le devoir,
le respect. Gardiennes de l'honneur de la famille, du nom de leur mari,
responsables de leur intérieur et de leurs enfants.
[...] Malvina détestait ce pays, cette ville de
rumeurs et de commérages. Elle détestait cette vie et s'était mise à lutter
contre elle. Elle avait commencé à lire. João Fulgêncio la guidait en lui
recommandant des livres. Elle découvrit qu'au-delà d'Ilhéus, il y avait un
autre monde où la vie était belle, où la femme n'était pas une esclave. De
grandes villes où l'on pouvait travailler, gagner son pain et sa liberté. Elle
ne regardait pas les hommes d'Ilhéus. Iracema la surnommait « la vierge de
bronze », le titre d'un roman, parce qu'elle n'avait pas d'amoureux. [...] Elle
aimerait celui qui lui offrirait le droit de vivre, qui la libérerait de la
crainte d'avoir le sort de toutes les femmes d'Ilhéus. Il valait mieux devenir
une vieille fille tout de noir vêtue, toujours fourrée à l'église, plutôt que de
mourir comme Sinhàzinha, d'un coup de revolver.
Jorge Amado : Gabriela,
girofle et cannelle - Chronique d'une ville de l'Etat de Bahia (1958)
Traduction de Georges
Boisvert
Editions Stock
 |
| « La pauvresse s'est muée en jeune et jolie mulâtresse au parfum de girofle et au teint de cannelle » (Jorge Amado) |